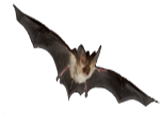 |
Les Chauves-souris ont-elles subi une perte d'effectif ? |
|
Depuis les années 50, les effectifs de Chauves-souris ont fortement décliné. Plusieurs causes expliquent ce phénomène, quelles soient directes (collisions routières, mort par asphyxie liée a un feu en cavité…) ou indirectes (destruction des habitats et épandage de pesticides…). Ces deux dernières décennies, on observe selon les régions une légère remontée des effectifs. Cette remontée reste faible et les effectifs restent fragiles.
|
|
|

Effectifs de Grand Murin (Myotis myotis) en hibernation dans une cavité du Jura (M. BAUER, 2004).
| |
|
|
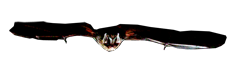 |
Quelles sont les causes directes de perte d'effectif ? |
|
Les Chauves-souris ont bien sûr des prédateurs naturels (rapaces nocturnes : chouette effraie, chouette hulotte, couleuvre d’Esculape, fouine, renard…) qui ont un impact minime et localisé sur les effectifs de Chauves-souris. Mais sans aucun doute, les chats domestiques, prédateurs agiles, sont les prédateurs qui détruisent le plus de Chauves-souris.
Les collisions routières touchent fortement les populations de Chauves-souris. Des autoroutes aux routes vicinales, ces axes représentent des barrières difficilement franchissables par la nature. Toutes les espèces ne sont pas logées à la même enseigne. Les Pipistrelles, Oreillards et Rhinolophidés volant près du sol sont en premières lignes. Le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges (ARTHUR L., LEMAIRE. M, 2009) a montré qu’un petit camion roulant 200 km quotidiennement au couché du soleil et à l’aube sur une centaine de nuit percutait 51 Chauves-souris.
D'autres Chauves-souris volant plus haut dans le ciel ou migrant sur de longues distances sont touchées par les éoliennes industrielles. L’emplacement des parcs éoliens (en zone forestière, en crête, axe de transit…) et les périodes de fonctionnement (par vent faible…) accentuent fortement la dangerosité des éoliennes. L’apparition de petites éoliennes domestiques avec un mat plus court, touchent, elles, des espèces volant bien plus bas comme les Murins. Des éoliennes « éco-compatibles » existent, avec des hélices encastrées protégeant les Chauves-souris et les oiseaux.
La destruction des individus pendant la période de reproduction ou d’hivernage est la cause de pertes massives des effectifs des populations de Chauves-souris. On retrouve dans ces contextes le rejointement des trous dans des ouvrages d’art et la fermeture des accès à une colonie pendant la période de présence des individus, qui meurent emmurés vivants dans leur abri. Les feux (le plus souvent volontaires) dans les cavités asphyxient les Chauves-souris présentes en hibernation et rendent les caves impropres aux Chauves-souris sur des dizaines d’années. Les dérangements pendant les périodes de léthargie font perdre aux individus des jours de réserve qui leur permettraient de passer les périodes maigres.
Les destructions volontaires liées aux superstitions, peurs, ou sans mobile concernent les espèces les plus visibles et les plus grégaires comme les Rhinolophidés qui sont aussi les plus vulnérables.
|
|
|

Eoliennes posées dans un habitat favorable aux Chauves-souris. |

Grand Murin (Myotis myotis) mort dans un grillage posé à l'entrée d'une colonie de reproduction. |
|
|
|
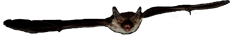 |
Quelles sont les causes indirectes de disparition ? |
|
Causes non visibles instantanément mais pouvant avoir un impact très important sur les effectifs d’une population de Chauve-souris. Parmi ces causes, un certain nombre est lié à l’agriculture productiviste et intensive. L’utilisation des pesticides dans l’agriculture réduit significativement le nombre d'insectes dont les Chauves-souris d’Europe se nourrissent exclusivement. On retrouve aussi une bioaccumulation de ces produits dans les organes des Chauves-souris. Les insectes contaminés par les polluants sont mangés par les Chauves-souris. Les molécules n’étant pas éliminées par ces dernières, la concentration en polluant augmente pour atteindre des niveaux rendant les individus malades. Les remembrements des parcelles agricoles, la destruction de mares, de haies, de bosquets et d’un habitat bocager, ont réduit comme peau de chagrin les territoires de chasse des Chauves-souris ainsi que leurs corridors (chemins) utilisés pour se déplacer entre les terrains de chasse. Les changements aussi au niveau des élevages, avec l’utilisation des vermifuges, des fermetures des étables, privent les Chauves-souris d’une manne d’insectes importante. De plus, un certain nombre de Chauves-souris attirées par les insectes se trouve englué au papier tue-mouche.
Au cours du 20e siècle, il n’y a pas que l’agriculture qui s’est modifiée. La sylviculture (l’exploitation de la forêt) s’est complètement réorientée. Pour plus de rendement, les forêts sont devenues de la monoculture, principalement de résineux. De plus, les arbres sont récoltés de plus en plus tôt et les arbres morts ou vieillissants sont abattus. On retrouve aussi des épandages de pesticides. Avec une telle gestion, les Chauves-souris ne trouvent plus de quoi se loger ni de quoi se nourrir. Depuis les années 90, on voit apparaître une sylviculture différenciée qui prend en compte les Chauves-souris dans les plans de gestion.
Les éclairages publics attirants certaines espèces comme les Pipistrelles et les Sérotines, font fuir les autres espèces plus lucifuges. On a observé des églises se vider de leur colonie suite à la mise en place de spots tout autour du bâtiment, ou des Chauves-souris sortir lorsque ceux-ci s’éteignent leur faisant perdre jusqu’à plus d’une heure de chasse.
Un grand nombre de colonies de reproduction en bâtiment se retrouve empoisonné par le traitement des charpentes par des produits tels que lindane, hexachloride, benzène, P.C.P, T.B.T… Les produits pulvérisés sur les charpentes où se situe la colonie s’imprègnent sur les poils des femelles pour être ingérés ensuite lorsque celles-ci se nettoient. Les jeunes sont aussi contaminés par la lactation, entrainant mortalité, malformation etc.
Les autres pollutions aux métaux lourds et autres polluants des cours d’eau et des bassins de rétention des eaux sont aussi une des causes indirectes de disparition des Chauves-souris.
|
|
|

Paysage agricole non favorable au Chauves-souris (L.P.O Anjou). |

Eglise éclairée (Benjamin Même-Lafond). |
|
|
|




